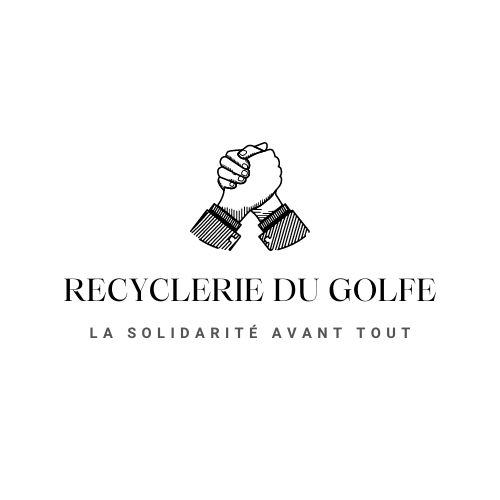Sous sédatif – comment le capitalisme dépolitise systématiquement la détresse mentale
James Davies tisse une histoire complexe et engageante qui démystifie et repolitise la compréhension dominante de la détresse mentale, écrit Jeandré Coetser
Comment se fait-il qu’au cours des 40 dernières années, de nombreux domaines de la médecine se soient améliorés à l’exception de la psychiatrie et de la santé mentale ? C’est la question que pose le Dr James Davies dans Sedated—How Capitalism Created Our Mental Health Crisis.
Il soutient que le capitalisme dépolitise systématiquement, surmédicalise et individualise notre approche et notre compréhension de la santé mentale
Sedated soutient que notre crise actuelle de la santé mentale découle des réformes néolibérales des années 1980. À l’aide d’études universitaires, d’entretiens avec des experts et d’analyses détaillées, Davies tisse une histoire complexe et engageante.
Il se penche sur l’ancienne première ministre conservatrice Margret Thatcher et sur la façon dont les gouvernements suivants sont restés attachés au néolibéralisme. Ils ont poussé des politiques telles que la privatisation, la suppression de l’État-providence, la gestion des services publics comme une entreprise et la répression des syndicats.
Chaque chapitre montre comment Thatcher et d’autres champions du néolibéralisme ont essayé d’utiliser l’économie pour changer le « cœur et l’âme des gens ».
La première moitié de Sedated est un exposé des moteurs de notre crise de santé mentale et des interventions qui la perpétuent. Les « interventions » vont des services d’amélioration de l’accès aux thérapies psychologiques (IAPT) aux secouristes en santé mentale sur les lieux de travail. Ils sont censés repérer les signes de détresse mentale et orienter les gens vers des services, mais sans s’occuper des problèmes de travail qui en sont à l’origine.
Davies ramène la politique dans la discussion et affirme que l’économie façonne ces interventions, dans le but de remettre les gens au travail.
Ces interventions renforcent l’idée que les individus sont responsables de leur propre chômage, redéfinissant le chômage comme un « déficit psychologique ». Ils contournent délibérément les problèmes structurels, tels que le manque d’emplois, la discrimination et la stigmatisation, qui peuvent entraver les opportunités d’emploi.
Davies explore le rôle de la dette en tant qu’outil utilisé pour masquer des problèmes structurels plus profonds dans le système. Il affirme que la déréglementation du crédit a normalisé l’emprunt comme moyen de joindre les deux bouts alors que les salaires stagnaient. En déréglementant le crédit, Thatcher a contribué à enfermer les gens dans l’endettement et toutes les pressions qui vont avec.
De même, Davies soutient que la prévalence des médicaments sur ordonnance est un autre plâtre, masquant des problèmes systématiques. Il dit que la promotion avide de médicaments, tels que les antidépresseurs et les antipsychotiques, sert les intérêts économiques des grandes sociétés pharmaceutiques. Pourtant, les preuves montrent que l’utilisation à long terme de ces médicaments réduit les taux de récupération.
Au début du XXe siècle, les traitements psychiatriques, tels que les lobotomies, les comas induits par l’insuline et les traitements contre la fièvre, étaient annoncés comme très efficaces. Mais finalement, ces thérapies se sont avérées extrêmement nocives pour les patients.
N’est-il pas alors raisonnable de se demander si le même battage publicitaire appliqué aux remèdes psychiatriques antérieurs peut être appliqué aux traitements actuels ? Et que cela conduit à la sur-prescription d’anti-dépresseurs et d’anti-psychotiques.
Ceci est fortement contesté par les psychiatres ayant des liens économiques avec les grandes sociétés pharmaceutiques. Mais les conclusions du livre remettent en question la croyance cultivée depuis longtemps, perpétuée par les grandes sociétés pharmaceutiques, selon laquelle les problèmes de santé mentale ont une base biomédicale.
Davies a raison de dire que les interventions en santé mentale dépendent trop d’un remède chimique. Mais ses affirmations sur l’inefficacité des médicaments sont trop noires et blanches. De nombreuses personnes dépendent de la drogue parce qu’elles en ont besoin, ce que Sedated n’aborde pas. Au contraire, si les interventions étaient façonnées par la voix des patients, cela pourrait favoriser une approche holistique qui combine la prescription de médicaments et les thérapies par la parole.
Davies propose qu’une approche plus efficace de la crise de la santé mentale nécessiterait des politiques qui s’attaquent aux racines sociales de la détresse. Ils comprennent, dit-il, une fiscalité plus progressive, le renforcement des syndicats et une meilleure protection sociale.
La seconde moitié de Sedated explique comment nous en sommes arrivés là. Il examine la façon dont la société nous apprend à accepter la cure chimique en plus de traiter les causes sociales de la détresse mentale.
Davies aborde largement les inégalités révélées par la pandémie. Il reconnaît à quel point les personnes à faible revenu et les Noirs ont été touchés de manière disproportionnée par Covid 19. Malheureusement, Davies n’explore pas vraiment la relation entre le racisme, le sexisme ou l’oppression des personnes handicapées et la santé mentale.
Il fait un clin d’œil à l’explosion de la colère populaire alors que le système nous plonge crise après crise.
Davies rassemble une polémique éclairante, qui démystifie et repolitise la compréhension dominante de la détresse mentale. Tout en brossant un sombre tableau, Sedated donne l’impression que le changement peut se produire.
Des interventions qui s’attaquent aux racines sociales de la détresse et centrent les besoins humains sont possibles. Mais seulement avec un changement de système.